Document
Gilles Le Boec sur la monnaie scripturale (Note à propos de la leçon N°167 « La sphère de la finance »)
Cette leçon m’est apparue particulièrement pertinente et je partage, pour l’essentiel, la vision de l’économie qu’elle présente. Cependant, le paragraphe qui suit présente, à mon avis, certaines lacunes qui ont des répercussions sur la suite de l’exposé. Ces lacunes me semblent courantes en macroéconomie car elles sont dues à une faiblesse générale de la diffusion d’une culture comptable. En pratique, les notions comptables les plus complexes ne sont maîtrisées que par les spécialistes : experts-comptables, commissaires aux comptes, directeurs financiers et cadres du secteur bancaire. Pourtant, une bonne connaissance de ces principes ferait tomber de nombreux mythes. Cette remarque concerne notamment les phénomènes monétaires qui sont, pour bonne partie, la conséquence du fonctionnement de la monnaie scripturale, monnaie qui, comme son nom l’indique, est générée par des mécanismes comptables.
Ce paragraphe est le suivant :
« En fait, ce n’est pas un conte! C’est une pratique qui remonte au Moyen-Age et qui a cours aujourd’hui dans des proportions bien plus élevées. Cela s’appelle crédit par création monétaire. Ce n’est pas de la "fraude", mais un "principe de fonctionnement". On cite le chiffre selon lequel les banques prêtent 70 fois plus d’argent qu’elles en ont en réalité. Le reçu était déjà une virtualisation de la valeur de l’or, mais il est possible d’aller plus loin et de ne même plus utiliser un papier-monnaie. La virtualisation aujourd’hui devient un transfert de chiffres d’un compte à un autre, un jeu d’écriture numérique et c’est tout. D’où le terme monnaie scripturale. On imagine mal une situation dans laquelle tout le monde viendrait retirer son argent, mais le risque du banquier subsiste. Comment fait-il pour s’en protéger ? Sa méthode consiste à fidéliser ses clients sur le long terme de manière à ce qu’ils laissent leur argent en banque. Le banquier va alors leur proposer pour cela des placements et des obligations avec un taux d’intérêt élevé. Jusqu’à une période assez récente, le politique gardait un contrôle sur l’économie. Ce sont les gouvernements qui se portaient garants des risques de banqueroute et ce sont eux qui décidaient de faire tourner la planche à billets. Un contrôle existait, jusqu’à une période récente, les banques devaient détenir une réserve… d’au moins 4% en argent liquide ! Mais l’indépendance du système financier s’est développée partout. L’économie a pris le pas sur la politique »
Si ce paragraphe n’est pas fondamentalement faux, la description de l’avènement de la monnaie scripturale et de son fonctionnement a besoin d’être éclairée par son caractère comptable. La monnaie scripturale est présentée ici comme une sorte de « virtualisation » du « papier-monnaie ». Sans rejeter l’idée que la monnaie scripturale présente un certain caractère virtuel, cette présentation des choses est peu fidèle à la réalité. La pratique historique du dépôt de la monnaie fiduciaire (les billets) dans les banques et celle de substituer au paiement par remise de ces billets, une écriture comptable (un virement de compte à compte commandé par un chèque, puis par d’autres techniques comme la carte bancaire) a abouti à la création d’un nouveau type de monnaie, la monnaie scripturale, totalement indépendante de la monnaie fiduciaire. La monnaie scripturale est une monnaie qui résulte d’une « monétisation de créance » : l’argent dont nous disposons sur notre compte-courant bancaire n’est rien d’autre qu’une créance que nous détenons sur notre banque, créance qui nous sert de monnaie. Il n’y a pas lieu de rechercher l’origine de cette créance qui peut être un dépôt de billets mais qui peut avoir, aussi, bien d’autres origines, comme nous allons le voir. Après la monnaie métallique (or et argent) on en est arrivé, comme le montre la leçon, à la monnaie fiduciaire (la monnaie-papier) qui au départ avait l’or pour garantie, puis la garantie de l’État ; cette dernière se concrétise sur le plan comptable par la composition de l’actif de la banque centrale, la Banque de France (au sein duquel se trouve un stock d’or, mais surtout des créances dont celles sur les pays étrangers, les devises). Un billet de banque est juridiquement une reconnaissance de dette envers le porteur du billet ; ce billet est émis par la banque centrale (aujourd’hui la Banque de France contrôlée par la BCE) ; tous les billets en circulation figurent au passif du bilan de la Banque de France (1ère ligne) ce qui leur confère leur valeur. En bref, les billets de banque sont des dettes de la banque centrale envers les porteurs de ces billets ; ils sont garanties par l’actif de la banque émettrice (c’est-à-dire, l’ensemble des biens et droits lui appartenant). Si la Banque de France perdait son actif (hypothèse qui ne pourrait arriver qu’en cas de crise très grave : guerre, crise économique du type de celle de 1929...) nos billets pourraient théoriquement perdre toute valeur. Ce qui est une dette pour la banque est évidemment une créance pour le détenteur du billet.
La monnaie scripturale est, elle aussi, une créance pour le titulaire d’un compte courant et une dette pour la banque de ce dernier. Mais cette créance naît de façon différente que la monnaie fiduciaire et ne doit pas être confondue avec elle ; l’essentiel de cette monnaie est émise par les banques ordinaires. Pour comprendre la nature de la monnaie scripturale, il est indispensable de faire un détour par quelques notions de comptabilité. Il n’est évidemment pas possible d’en faire un exposé exhaustif ici. Je reprendrai simplement quelques paragraphes de mon livre, « Sortir du despotisme de l’ignorance économique ».
Notions comptables indispensables. La comptabilité moderne que nous utilisons, celle qui sert, par exemple, à tenir nos comptes bancaires, est « une très vieille dame ». Jusqu’au Moyen-âge et depuis l’Antiquité, on utilisait une comptabilité simple qui consistait à enregistrer toutes les entrées et sorties de matière et de numéraire. C’est le développement du crédit qui, à la fin du Moyen-âge, a amené les commerçants italiens à développer la comptabilité en partie double. Les travaux de Luca Pacioli[1] (1445 – 1510) ont eu, en particulier, une grande influence sur le développement de la méthode. C’est toujours cette comptabilité que nous utilisons et dont les règles ont été reprises par notre « plan comptable général » et par le Code de commerce. Actuellement, ces règles sont progressivement adoptées par la comptabilité publique. Il faut donc se méfier du langage courant en matière comptable ; par exemple, la notion centrale de bilan n’a rien à voir avec la notion courante de bilan, dans les associations par exemple, où le bilan dont on parle n’est souvent qu’un compte d’entrées de sorties. Dans la comptabilité en partie double, le bilan, composé de l’actif et du passif, est une représentation chiffrée du patrimoine (droits à l’actif, obligations au passif) de l’entité qui tient la comptabilité ; le compte de résultat qui s’apparente seulement à un compte d’entrées et de sorties, décrit en fait, les causes de la variation du patrimoine pendant une période donnée.
On peut noter qu’une sorte de financiarisation de l’approche comptable, notamment dans la façon dont la comptabilité est enseignée depuis quelques années, peut contribuer à dénaturer l’image de ce qu’est réellement la comptabilité en partie double : une comptabilité du patrimoine. Son premier rôle est de répondre à la question : que possède et que doit la personne morale ou physique, dont la comptabilité est ainsi tenue ?
Héritière d’un long passé, la comptabilité générale est désormais devenue très formelle, car elle a servi de support à de nombreuses règles de droit. La comptabilité est d’abord un moyen de preuve à l’égard des tiers. Aussi, le Code de commerce comprend désormais un certain nombre d’articles qui constituent le cadre unique, en France, des règles comptables générales, applicables à tous les commerçants, personnes physiques ou morales (y compris les banques, avec quelques particularités de forme). Ces règles reprennent celles du « plan comptable général ». En cas de contestation sur le montant ou la nature de créances, les tribunaux peuvent se référer aux éléments comptables ou demander une expertise ; dans ce cas, l’expert se basera d’abord sur un examen précis des comptabilités. Compte tenu de l’importance des écritures comptables, notre code pénal a d’ailleurs développé des moyens de répression pour les faux en écriture comptable.
La comptabilité sert donc d’arbitre pour répondre à la question : « Qui doit quoi et à qui » ? Elle sert ensuite à donner une certaine réponse à la question : « Quelle est la valeur de l’entreprise » ? Elle sert enfin à permettre à la collectivité de réclamer son dû. La comptabilité sert à déterminer l’assiette (la base) de nombreux impôts, notamment la TVA et l’impôt sur le bénéfice des entreprises (les sociétés, mais aussi, les affaires en nom propre).
Examinons rapidement comment la technique et le droit comptable ont donné naissance à cette nouvelle monnaie, la monnaie scripturale, qui est aujourd’hui la plus utilisée. Pour saisir l’importance de la monnaie scripturale examinons, à titre d’exemple, les chiffres à la fin de l’année 2004 : la masse monétaire directement disponible pour les paiements (appelée : M1) était de 493,7 milliards d’euros ; mais il existait des placements à court terme, facilement transformables en liquidités, pour 788,4 milliards d’euros. Ainsi la totalité de la masse monétaire (appelée : M3) était de 1282 milliards d’euros. La monnaie fiduciaire (billets émis en circulation) ne représentait que 91,4 milliards d’euros, soit 18%. A titre anecdotique, le stock d’or de la Banque de France était de 30,8 milliards d’euros à cette date (selon le bilan de la Banque de France au 31/12/2004).
Reprenons en quelques mots les points suivants : la nature de la monnaie scripturale, un bref historique de la naissance de son mécanisme, les conséquences macroéconomiques de son fonctionnement.
a)- Nature de la monnaie scripturale.
Un adage nous dit que « nous payons nos dettes avec des dettes ». On peut le comprendre puisque un compte courant bancaire est en fait le compte de la dette que notre banque a envers nous. Ce compte figure au passif du bilan de la banque. Mais l’adage est faux en ce sens que ce qui est une dette pour le débiteur, la banque, est une créance pour le titulaire du compte. Le paiement en monnaie scripturale est, en fait, un transfert de créance : nous remettons une créance en paiement de notre dette. Effectuer un paiement par chèque ou par virement revient à dire à celui à qui on doit une somme : « désormais ce n’est plus moi qui vous devrai la somme de x euros, mais ma banque. Si vous n’avez pas de compte ouvert à ma banque, ma banque se reconnaîtra débitrice de votre propre banque au lieu de l’être à mon égard ; ceci se fera par l’intermédiaire de la banque centrale qui est aussi « la banque des banques » ; en contrepartie de l’augmentation de sa créance à la banque centrale, votre banque se reconnaîtra donc débitrice de cette même somme à votre égard (elle l’inscrira donc au crédit de votre compte). »
On voit que, contrairement à une pièce d’or qui est ici ou là, mais dans un seul endroit à la fois, il n’y a de monnaie scripturale que s’il y a un débiteur et un créancier ; cette monnaie existe concrètement par la seule transcription réciproque qui en résulte dans les comptes des deux membres du binôme (elle est virtuelle si le détenteur du compte ne tient pas de comptabilité). Le transfert de monnaie se fait par un changement de l’identité des membres du binôme.
Mais qu’elle est la valeur de cette créance ? N’est-elle pas une vue de l’esprit, le fruit d’un « jeu comptable », une valeur virtuelle ? La réponse est que toute créance, qu’elle soit monétaire ou ordinaire (les créances sur les clients qui figurent à l’actif de toute entreprise, par exemple) est un engagement du débiteur de pouvoir disposer de la valeur nécessaire pour honorer sa dette, à l’échéance ; c’est donc un pari sur le flux des revenus futurs du débiteur. Notre droit comptable, sous certaines réserves de prudence, considère qu’une créance est un actif, c’est-à-dire une valeur dans le patrimoine, comme tout autre actif : la dette de cent euros que doit un client a la même valeur patrimoniale qu’une marchandise ou une machine, estimées à cent euros chacune. Evidemment, cette réalité comptable a un caractère conventionnel ; si l’économie s’effondre entre temps, la créance risque de ne pas être encaissée ; mais, la marchandise peut aussi ne pas trouver preneur et n’avoir plus aucune valeur. Autrement dit, nos mœurs comptables et leur traduction législative (le droit comptable) entérine une idée, sans doute très contestable pour la sagesse philosophique : un bien réel a la même valeur qu’une créance fondée sur le fait que le débiteur a toutes les chances de savoir créer, dans un proche avenir, une richesse équivalente à sa dette qui lui permettra de la payer (par échange économique). C’est ainsi que la crise bancaire dite des surprimes aux États-Unis provient du fait que les banques ont monétisé des créances sur des ménages qui n’ont pas été capables de créer ou de participer à la création de suffisamment de richesses pour obtenir les revenus nécessaires pour payer leurs dettes ; elles ont donc « fabriquer de la monnaie scripturale » avec un pari qui s’est avéré un « matériau » économiquement trop fragile.
En résumé, toute créance, bien qu’elle ait toujours un caractère de « pari sur l’avenir », est considérée en économie comme un actif ordinaire ; avec une créance, une banque peut donc faire de la monnaie. Certes, faire figurer à l’actif d’un bilan une créance fictive ou très risquée pourrait constituer un délit de présentation de faux bilan ; le commissaire aux comptes, notamment, doit s’assurer de la fiabilité de ces créances avant de certifier la sincérité des comptes annuels. Mais, comme tout homme, les responsables comptables ne peuvent que prendre des précautions car ils n’ont nullement le pouvoir de lire l’avenir. Nous sommes dans une économie en permanence « sur le fil du rasoir » entre passé et avenir.
De ce fait, comme vous l’avez bien mis en évidence, la spéculation est devenue une activité primordiale et notre économie présente de plus en plus un caractère d’affaire de « bookmakers » sur les créances et, par conséquence, sur les entreprises qui constituent les principaux paramètres déterminant les chances de bonne fin de ces créances. Le comble de l’histoire est que, avec le phénomène de la financiarisation, on en est arrivé à considérer que ce jeu de paris est plus important pour faire des profits que la gestion de la production elle-même ; c’est un peu comme si, dans le milieu des courses hippiques, on en était arrivé à considérer que le suivi des pronostics est essentiel et qu’il n’est pas important de nourrir et d’entraîner les chevaux !
b) – Bref historique de la naissance du mécanisme de la monnaie scripturale.
Nous partirons de ce vieil adage dans le monde bancaire : « les dépôts font les crédits et les crédits font les dépôts ! ». Comme l’évoque le petit conte de l’orfèvre de votre texte, les banques ont appris à collecter les dépôts de monnaies, qu’elles soient en or, en argent ou en billets. Si on a vu fleurir aux quatre coins de nos rues des agences bancaires, c’est bien évidemment à cause de la concurrence que se font les banques pour collecter le maximum de dépôts ; pour avoir été administrateur bénévole d’une banque locale mutualiste, j’ai vécu cette course à la « captation des comptes-courants ».
Mais, là, il faut sortir d’une sorte de mythe. Lorsque les dépôts se faisaient en monnaie fiduciaire (des billets) le banquier ne mettait pas dans un coffre les billets de son client pour pouvoir les lui rendre quand bon lui semblerait. En fait, ces dépôts deviennent la propriété de la banque qui, en contrepartie, se reconnaît débitrice d’une somme équivalente dans ses comptes ; de là sont apparus les comptes-courants. Ce compte-courant s’est avéré, petit à petit, être ce « matériau » de la monnaie scripturale décrite ci-dessus : pour payer, au lieu de céder de la monnaie-papier, on cède la créance que l’on a sur sa banque. La banque avait donc à son actif de la liquidité sous forme de billets de banques et à son passif des dettes envers ses clients. Mais ces derniers, pour utiliser leur argent ont, dès lors, deux solutions : aller rechercher des billets pour payer, ce qui provoquera un débit équivalent sur les comptes-courant, ou établir un chèque et transférer leurs créances à leurs propres créanciers. Cette seconde solution ayant tendance à se généraliser, la banque risquait de se retrouver avec de la monnaie fiduciaire en excédent. Ainsi, comme indiqué dans le cours, même si il ya toujours une demande de monnaie fiduciaire, elle devient secondaire car elle n’est plus qu’accessoire comme mode de paiement. Les banques n’avaient donc plus besoin que d’un certain stock de monnaie fiduciaire qui pouvait être évalué en pourcentage du total des comptes-courants. Dès lors, si ce stock était supérieur à ce « stock-outil », il leur était possible d’augmenter les comptes courants qui avaient la qualité de monnaie scripturale, sans risque de manquer de monnaie fiduciaire.
C’est là qu’intervient le processus de création monétaire par les banques ordinaires. Contrairement à une idée reçue, largement répandue, ce sont les banques ordinaires qui créent le plus de monnaie, mais, bien entendu, de la monnaie scripturale uniquement. Elles le font en accordant des crédits à leurs clients. C’est ainsi que l’on qualifie cette création monétaire de création « ex nihilo » : lors de l’attribution d’un crédit, apparaît donc de la monnaie qui n’existait pas auparavant. Par exemple, si monsieur Durand obtient un crédit de 100 000 euros, son banquier va inscrire à l’actif de son bilan une créance de 100 000euros et à son passif une dette équivalente ; cette dette étant inscrite au compte-courant, elle devient de la monnaie, dite monnaie scripturale. Là encore, contrairement aux idées reçues, le banquier n’a pas besoin d’avoir collecté une épargne équivalente, puisqu’il crée la monnaie prêtée ; nous verrons cependant que l’épargne ne lui est pas inutile. Evidemment, cette monnaie n’aura qu’une vie limitée, car à chaque remboursement, il y aura un prélèvement sur le compte courant (donc suppression de monnaie) qui aura pour contrepartie la diminution de la créance de la banque sur son client, créance qui, elle ne fait pas fonction de monnaie. La monnaie scripturale en circulation est donc composée d’un en-cours de créances ; si les acteurs économiques se mettent à moins emprunter, la masse monétaire se rétracte.
Le procédé peut paraître surprenant dans la mesure où il semble ne plus y avoir de limites à la création monétaire. Nous allons voir que ce n’est pas le cas, mais il faut retenir que c’est ce procédé qui explique le développement de la masse de monnaie en circulation, avec l’effet d’entraînement capital pour la croissance. Après la découverte des Amériques par Christophe Colomb, l’économie espagnole fût dopée par l’arrivée d’or monétisable ; de la même manière, la création de monnaie par le crédit a sûrement joué un rôle considérable au vingtième siècle et, en particulier, après la guerre 39-45, pendant les trente glorieuses.
En quelques mots les limites à la création monétaire rencontrées par les banques sont les suivantes :
- Limites liées aux besoins de liquidité des banques. Lorsqu’une banque (disons la banque A) va accorder un crédit à une entreprise ou à un ménage, elle va donc créditer son compte-courant. Le bénéficiaire va lui-même payer ses fournisseurs. Si ceux-ci étaient tous clients de la même banque, les paiements effectués ne provoqueraient aucun besoin de liquidité pour la banque A ; en effet, le paiement consisterait à diminuer un compte-courant pour en augmenter un autre ; le total des comptes-courants (donc de la dette due par la banque à ses clients) ne changerait pas. Malheureusement pour elle, il est fort probable que ce ne sera pas le cas. Lorsque les bénéficiaires des chèques les auront remis à leurs propres banques, celles-ci vont se trouver créancières de la banque A. Cependant, toutes les banques faisant le même métier, la banque B ou la banque C ont pu, elles aussi, accorder des crédits produisant un effet réciproque. Il y a compensation entre les « créances nettes » et « dettes nettes » qui résultent des paiements des clients des diverses banques ; celle-ci se fait, comme indiqué ci-dessus, par un compte qui est tenu par la banque centrale. Cependant, selon la part de marché détenue par chaque banque (d’où l’empressement des banques à bien occuper tout le territoire) et sa propension à accorder du crédit, son propre compte à la Banque de France peut devenir débiteur au delà des limites autorisées. Elle devra alors trouver des liquidités en se « refinançant » ; la banque centrale peut accorder ce financement moyennant un intérêt. C’est à partir de ce taux d’intérêt et du coût qu’il représente pour les banques ordinaires que la banque centrale va exercer une pression pour limiter la création monétaire par le crédit. Un peu de la même manière, la demande de monnaie fiduciaire (les billets) revient à détruire de la monnaie scripturale (débit du compte courant de la banque demandeuse) pour créer cette monnaie spécifique au niveau de la banque centrale ; la demande de monnaie scripturale contribue aussi à limiter les émissions de crédits. Notons toutefois que les banques vont aussi limiter leurs recours auprès de la banque centrale en collectant de l’épargne. La collecte de l’épargne contribue ainsi à amplifier la possibilité d’accorder des crédits.
- Limites inhérentes à la politique monétaire. Lorsque les banques ont besoin de trésorerie, comme nous l’avons vu, la banque centrale peut leur racheter des créances et créer ainsi de la monnaie de banque centrale. Ainsi, dans l’hypothèse émise ci-dessus, notre banque A pourra compenser son insuffisance en se refinançant, selon ce principe. Mais, pour contrôler la création monétaire (par peur de l’inflation, notamment) la banque centrale peut limiter le volume de ce refinancement. Les banques se voient également imposer des ratios de réserves obligatoires : elles doivent limiter leurs dettes (donc les comptes-courants formant la monnaie scripturale) en fonction de certains critères comme le montant de leurs capitaux propres. Enfin, comme évoqué ci-dessus, la banque centrale détermine le taux d’intérêt auquel elle refinance les banques : plus le coût de refinancement sera élevé et plus les banques éviteront d’y avoir recours. Une banque qui ne veut pas subir le coût d’un refinancement doit donc se limiter dans l’octroi des crédits.
c) – Conséquences macroéconomiques.
La quantité de monnaie en circulation est un paramètre qui a une influence reconnue par tous les économistes, sur l’activité économique. Il s’agit d’un vaste sujet qui fait l’objet de nombreux débats ; les monétaristes (comme Friedman qui a eu beaucoup d’influence sur la politique des États-Unis et de la zone euro ; la politique de la BCE est essentiellement monétariste) considèrent que la régulation de cette masse monétaire est un paramètre essentiel de la politique économique. Il est évidemment impossible de faire un exposé complet du sujet ici. Signalons simplement que la demande de biens, de services et d’investissements, est influencée par la quantité de monnaie en circulation, qui doit être suffisante pour stimuler l’activité, mais non excédentaire pour éviter l’inflation. A mon sens[2], le problème est plus complexe ; il y a une partie de la masse monétaire qui circule de façon bénéfique à la croissance dans le cycle de base de l’économie, celui des échanges entre les entreprises et les ménages, consommation d’un côté, revenus de l’autre. Il y a par ailleurs une partie de la masse monétaire qui s’oriente vers l’épargne ; une partie de ces flux entre dans le jeu de la spéculation que votre leçon a bien décrit, avec son univers mental très déconnecté de l’objectif naturel de l’économie.
Mais le plus important c’est qu’à travers des opérations purement financières, comme le LBO (Leverage Buy Out), il y a une création monétaire par le crédit qui vient alimenter cette spéculation[3]. En deux mots, il s’agit d’accorder un crédit à une société (holding financière) pour racheter tout ou partie des titres d’une société cible, société qui produit directement des biens ou des services et dont l’outil de production est déjà financé. Le plus souvent, l’opération est faite dans l’espoir de la revendre avec une plus-value. Ainsi circulent des masses importantes de monnaies en recherche de sociétés cibles pour spéculer purement et simplement ; c’est l’activité économique « à la mode » !
La monnaie a trois fonctions. La première et la plus importante économiquement est celle d’être l’intermédiaire des échanges ; elle évite le troc et rend possible les échanges de richesses dans un monde où le travail est parcellisé. Mais, l’économie reste fondamentalement l’activité humaine de production des richesses nécessaires et l’organisation des échanges qui reste un troc, au second degré ; les équations de la comptabilité nationale le démontrent puisque le PIB représente à la fois les revenus et la richesse produite. La deuxième fonction de la monnaie est celle de servir d’unité de mesure des valeurs ; la baguette de pain vaut x euros. La troisième enfin est une fonction de réserve de valeur. Elle doit constituer un moyen pour différer le pouvoir d’achat.
Avec la financiarisation, cette troisième fonction est devenue primordiale, directement ou par l’intermédiaire de l’acquisition de valeurs comme les actions cotées en bourse. Mais, comme nous l’avons vu, la monnaie n’est qu’une créance, c’est-à-dire un pari sur l’avenir. Un titre de société l’est aussi : c’est, pour l’essentiel, un droit à percevoir les dividendes des bénéfices futurs des entreprises. Dans un cas comme dans l’autre, la bonne fin du pari dépendra de la bonne santé de l’activité économique. Pourtant, en cherchant sans cesse à détourner la monnaie du cycle de base de l’économie, celui où l’on produit, pour l’orienter vers la spéculation, les épargnants ont tendance à créer eux-mêmes les conditions de la récession économique ; c’est, à mon sens, ce qui se passe actuellement dans les pays de l’OCDE. La mondialisation des marchés accélère le processus en permettant aux entreprises et aux financiers de rechercher toujours le moindre coût pour augmenter les bénéfices et, partant, augmenter la part des flux de monnaie qui vont s’orienter vers l’épargne et la spéculation. En outre, en achetant dans les pays qui produisent au moindre coût, on renonce aussi à créer des revenus salariaux chez nous. La situation actuelle et les problèmes évidents de stagnation, voire de régression, du pouvoir d’achat sont évidemment en grande partie la conséquence de ces phénomènes.
Comme j’ai tenté de le montrer dans le dernier chapitre de mon livre, la spéculation aboutit, en fait, à une stérilisation d’une partie de la monnaie ; elle s’apparente à une sorte de thésaurisation. Les spéculateurs sont « les Harpagons » des temps modernes ; au lieu d’enfermer leur argent dans des coffres, ils l’enferment dans les jeux spéculatifs transformant, selon l’expression de Keynes, l’économie en « économie de casino ».
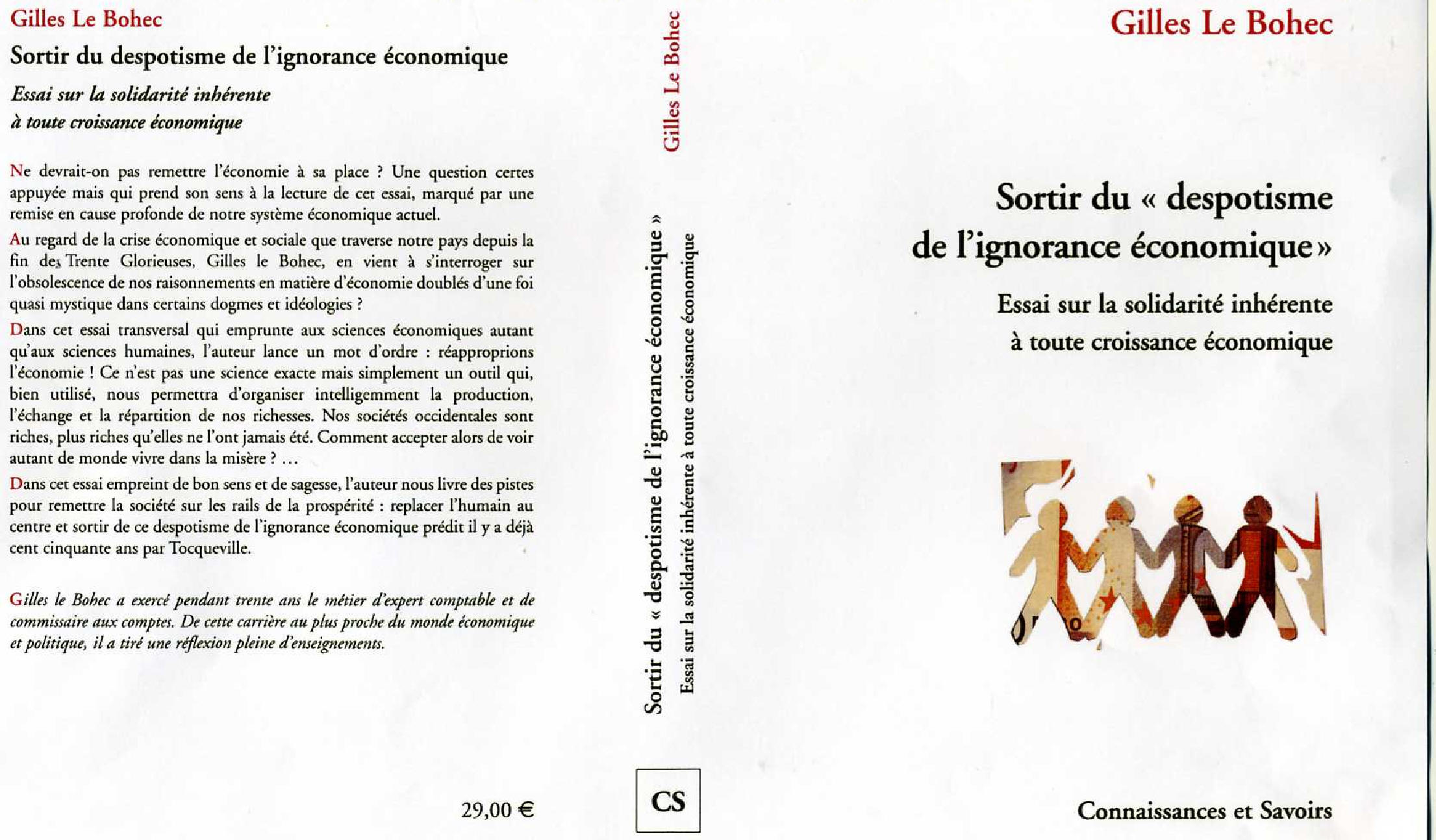
[1] Luca Pacioli (1445 – 1510) est un moine mathématicien italien. Il est considéré comme l’inventeur de la comptabilité dite de la méthode vénitienne, toujours utilisée de nos jours sous le nom de comptabilité en partie double. Il était également ami et professeur de mathématiques de Léonard de Vinci.
[2] Cette analyse semble aussi être celle de Patrick Artus dans son livre paru récemment, Les incendiaires – les banques centrales dépassées par la globalisation.- Editions Perrin - Il nous dit (p. 82) : « Dans la zone euro, l’inflation oscille autour de 2% par an. Le Royaume-Uni a conservé, de 1998 à 2005, une inflation extrêmement faible, alors que les prix de l’immobilier ont progressé de 15 à 25 % par an. Au Japon, de 1986 à 1989, avant la crise patrimoniale, l’inflation était inexistante, les cours boursiers ont été multipliés par trois et les prix des maisons ont augmenté de 40 à 60%. En réalité, prix des biens et des services et prix des actifs sont totalement déconnectés, et leurs évolutions posent deux problèmes distincts aux banques centrales. »
[3] J’ai développé l’exposé de ces mécanismes dans mon livre (notamment chapitre 1 de la deuxième partie)
Bienvenue|
Cours de philosophie|
Suivi des classes| Documents|
Liens sur la philosophie|
Nos travaux|
Informations
philosophie.spiritualite@gmail.com