Jean Anouilh Antigone
Éditions :
table ronde ; 1942
Thème : Justice
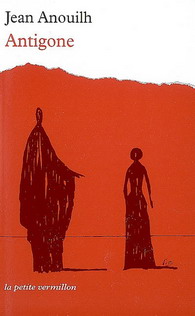 En plus des habituelles
problématiques liées au destin et à la liberté humaine, la pièce tragique de
Jean Anouilh, Antigone, soulève des questions relatives à la justice.
L'action de la pièce fait suite au conflit qui opposa Etéocle et Polynice,
les deux frères d'Antigone, tous deux désireux de s'emparer du pouvoir dans
la cité de Thèbes. Pour lutter contre son frère et assiéger la ville,
Polynice décide de faire appel à une armée étrangère. La lutte se clôt
finalement sur la mort des deux frères. Leur oncle Créon, à qui le pouvoir
revient, ordonne de préparer des funérailles somptueuses à Etéocle, le bon
frère, tandis qu'il interdit à quiconque d'ensevelir le corps de Polynice
qu'il condamne à pourrir au soleil, coupable à ses yeux de trahison. Il
annonce que celui qui tentera d'enterrer Polynice sera puni de mort. Malgré
cet avertissement, Antigone sort du palais pendant une nuit et recouvre le
corps de son frère de quelques poignées de terre symboliques. Antigone et
Créon défendent des positions radicalement opposées concernant la façon dont
le corps de Polynice doit être traité pourtant ils sont tous les deux animés
du sentiment d'agir justement.
En plus des habituelles
problématiques liées au destin et à la liberté humaine, la pièce tragique de
Jean Anouilh, Antigone, soulève des questions relatives à la justice.
L'action de la pièce fait suite au conflit qui opposa Etéocle et Polynice,
les deux frères d'Antigone, tous deux désireux de s'emparer du pouvoir dans
la cité de Thèbes. Pour lutter contre son frère et assiéger la ville,
Polynice décide de faire appel à une armée étrangère. La lutte se clôt
finalement sur la mort des deux frères. Leur oncle Créon, à qui le pouvoir
revient, ordonne de préparer des funérailles somptueuses à Etéocle, le bon
frère, tandis qu'il interdit à quiconque d'ensevelir le corps de Polynice
qu'il condamne à pourrir au soleil, coupable à ses yeux de trahison. Il
annonce que celui qui tentera d'enterrer Polynice sera puni de mort. Malgré
cet avertissement, Antigone sort du palais pendant une nuit et recouvre le
corps de son frère de quelques poignées de terre symboliques. Antigone et
Créon défendent des positions radicalement opposées concernant la façon dont
le corps de Polynice doit être traité pourtant ils sont tous les deux animés
du sentiment d'agir justement.
I Antigone, la justice commutative
Indifféremment des actes commis par ces derniers, Antigone estime que ses deux frères ont droit à un traitement semblable, en l'occurrence une sépulture décente. Par conséquent Antigone avance malgré elle une égalité en droit inaltérable entre tous les hommes, en tant qu'être humain. Elle applique une justice commutative qui soutient que chaque homme a droit aux mêmes choses, indépendamment des choix qu'il a pu effectuer. Elle considère la décision de son oncle Créon comme contraire à la justice et à la morale.
II Créon, la justice distributive
Pour Créon, c'est justement la volonté d'Antigone d'accorder un même traitement aux deux frères qui va à l'encontre de la morale. Pourquoi le "mauvais frère" qui a trahi la cité aurait droit aux mêmes avantages que le "bon frère"? Créon exerce une justice distributive, c'est à dire qu'il donne des avantages aux individus en fonction de leurs mérites. Selon lui, ne pas punir le "mauvais frère" serait une aberration et lui accorder un traitement semblable à celui du "bon frère" dévaloriserait les vertus de ce dernier.
III Le mérite
Les deux protagonistes ont donc la certitudes d'agir en vertu des lois de la justice et la morale. Cependant leurs opinions opposées ouvrent la voie à une multitude de questions. Chaque homme mérite-t-il le même traitement en tant qu'être humain ou bien existe-t-il des différences de mérite entre les individus? Si l'on considère avec Créon qu'il y a des différences de mérite entre les hommes, comment déterminer ces différences? Nous sommes tentés de répondre que le mérite ne peut concerner que les choix de la libre volonté de l'individu (on ne peut, par exemple, dire de quelqu'un qu'il est méritant parce qu'il est blond) ; mais il faudrait alors déterminer jusqu'à quel point un choix a été libre. En réalité plus grande sera la liberté que nous attribuerons à l'homme, plus significative sera la notion de mérite.
Pauline Raveau
![]()
Bienvenue|Cours de philosophie|
Suivi des classes| Littérature et philosophie|
Liens sur la philosophie|
Nos travaux| Informations
philosophie.spiritualite@gmail.com