
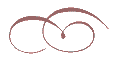
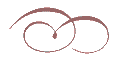
TPE, travaux personnels encadrés, année 2003
par Laure Cazeaux, Marie Lartigue, Emilie Fournet.
page 1, page 2, page 3, page 4, page 5, page 6, page 7, page 8, page 9, page 10, page 11.
2 –Religieux :
Les critiques religieuses avancées par les philosophes et les encyclopédistes furent plus importantes car elles s’adressaient directement aux personnes concernées.
La confiance dans la science et la raison devait pousser les hommes du 18ème siècle à rejeter le surnaturel et donc toutes les religions révélées. Voltaire se plut alors à tourner en dérision les dogmes, les clergés et les pratiques religieuses qu’il jugeait trop ‘conventionnelles et infondées ». De plus, l’Encyclopédie fut accusée « d’élever les fondements de l’irréligion et de l’incrédulité » (arrêt de 1752), car les hommes tels que les philosophes ne se basent généralement que sur des faits réels et prouvés et doutent des miracles.
En effet, les philosophes se rallient davantage à la religion naturelle, c’est-à-dire à la croyance et à l’existence de Dieu, à l’immortalité de l’âme et à une morale qui ordonne les vertus traditionnelles. De ce fait, les abbés Mallet et Yvon respectent l’orthodoxie, mais revendiquent la liberté de penser.
A travers cette Encyclopédie, les philosophes reprochent au catholicisme d’être intolérant et fanatique, ce qui prouve que beaucoup d’encyclopédistes sont déistes et certains penchent même parfois vers l’athéisme.
B- Une libération des esprits ?
Passage de l’ignorance au savoir :
Grâce à l’Encyclopédie, les hommes ont accès à un savoir quasi-total.
En effet,en comptabilisant le nombres de textes ,de planches,de
suppléments,etc. , on atteint 35 volumes regroupant différents thèmes
,notions, mots , à travers plusieurs matières à savoir
physiques, mathématiques, etc., ou encore à travers des notions
politiques, philosophiques, etc.
Le projet se consulte comme un dictionnaire, sous forme d’articles et
d’illustrations.
Les hommes qui autrefois vivaient, selon la tradition en obéissant aux
règles imposées par la société sans pouvoir juger par eux-mêmes des
choses, peuvent maintenant consulter dans l’Encyclopédie toutes les
branches de la connaissance
C’est en ce sens que les philosophes ont travaillés au « projet du plus
beau monument qu’aucun siècle ait jamais élevé à la gloire et à
l’instruction du genre humain » (comme le qualifie Neigeons) ; dans un
désir de progrès en observant la nature humaine comme une donnée avec
la volonté d’en tirer le meilleur parti.
Cependant, pouvons nous dire de façon certaine que l’ouvrage est
accessible à tous?
Il est clair que pour les illettrés, les pauvres qui constituent la
majeure partie de la population, la lecture s’avère difficile.